 |
Comment vivait-on à
Sfax ?
(4) |
|
|
 |
Les Tunisiens
|
|
|
|

|
|
Femmes
de la campagne de Sfax
(CPA Imp. Dépêche n°7 - Coll.
Ch. Attard)
|
|
|
|
|

|
La population tunisienne,
de beaucoup la plus importante, vivant essentiellement dans la médina ou,
pour les plus aisés, dans des maisons traditionnellement entourées de
jardins (les j’nens) dans les quartiers périphériques (les r’bats),
se divisait en deux catégories :
1) les Sfaxiens continentaux : avocats, médecins, professeurs d’arabe,
artisans, commerçants et employés au Sfax-Gafsa ;
2) les Kerkenniens qui étaient pêcheurs, dockers et manutentionnaires
(alfa et phosphate).
|
|
Photo A.Perrin, extraite
de :
" Le réseau de la Cie des phosphates et du chemin de fer de
Gafsa"
(Document : G. Bacquet)
|
|
|
|
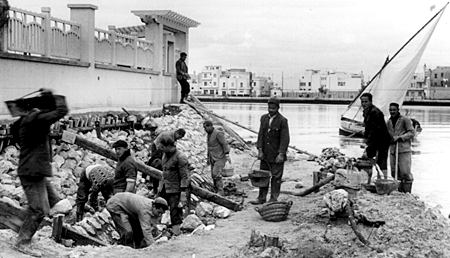
|
|
Ouvriers
et manœuvres travaillant à la reconstruction du port en 1949.
(Document René et Michèle Leroux)
|
|
|
|
Tous étaient sérieux dans leur travail, manifestant une grande
conscience professionnelle, même en période de Ramadan.
|
|
|
|
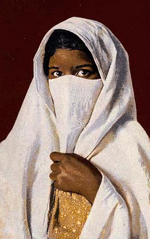
|

|
|
Costume
traditionnel
CPA 750 - Lehnert et Landrock Coll. Ch. Attard
|
Costume
traditionnel
CPA V. P.
N°55 - Coll. Ch. Attard
|
|
|
|
|
Les hommes étaient, dans
leur grande majorité, vêtus de façon traditionnelle, mais après
1944, de plus en plus de tunisiens, surtout les jeunes qui fréquentaient
les collèges de garçons, s’habillèrent à l’européenne.
|
|
|
|

|
Quant
aux femmes, elles ne sortaient que voilées, certaines se couvrant même d’un
grand "haïk" de couleur blanche, dont la fermeture en triangle
au niveau du visage ne leur permettait de ne voir que d’un seul œil.
Contrairement
aux hommes, cela perdura jusqu’à l’indépendance et aux lois sur le
statut des femmes édictées alors par le Président Bourguiba.
A noter
cependant que les tunisiennes employées, en tant que personnel de
maison (femmes de ménage, gardes d’enfants), dans les familles
européennes, y travaillaient en portant une tenue simple, avec tout au
plus un foulard discret retenant les cheveux.
|
|
Une
femme de ménage sfaxienne en 1950.
(Photo Coll. Ch. Attard)
|
|
|
|
Les
Sfaxiens étaient hospitaliers et ils invitaient des européens à
manger chez eux, mais ceux-ci n’apercevaient pas les femmes de la
maison qui travaillaient à la cuisine, d’où elles ne sortaient qu’après
le départ de leurs hôtes.
|
|
|
|
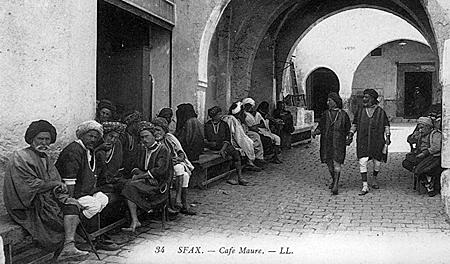
|
|
(coll. G. Bacquet)
|
|
|
|
Il était donc très difficile à un
européen de rendre une invitation, d’autant plus que s’y ajoutaient
les interdits religieux concernant la nourriture. Ces derniers avaient
aussi cours dans le cas des juifs orthodoxes.
Concernant la gestion
des affaires municipales, les conseillers municipaux tunisiens qui
étaient minoritaires en nombre (voir annexe), y participaient
activement même si les grandes orientations de la politique
municipale étaient essentiellement définies par les européens.
|
|
|
|

|
|
Petits cireurs de
chaussures.
(CPA LL n°114 - Coll. Ch. Attard)
|
|
|
|
Les Sfaxiens étaient
portés sur la politique où ils étaient compétents et dont, entre
autres Ferhat Hached et Habib Achour ont été de bons animateurs dans
les organisations syndicales. Une des erreurs de l’administration
française (surtout après la guerre de 1939-45) a été, plutôt que de
les écouter, de les combattre et même de les faire disparaître. |
|
|
|

|
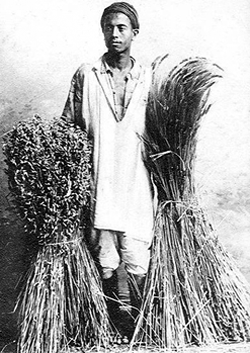
|
|
Un riche
marchand.
(Photo
Garrigues - Tunis - Coll. Ch. Attard)
|
Et un
pauvre ouvrier.
(Photo Société des Fermes françaises de Tunisie
Coll. Ch. Attard)
|
|
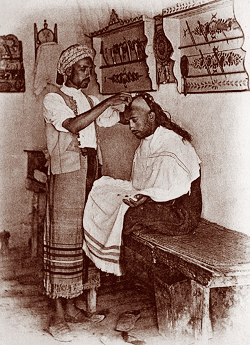 |

|
|
Un
barbier et son client sur cette carte
oblitérée en décembre 1900.
(CPA
ND Photo
n°134 - Coll. Gérard Bacquet)
|
CPA 6858
-
Lehnert et Landrock
(Coll. Ch. Attard)
|
|
|
|

|